3 août 2005
3
03
/08
/août
/2005
22:00
monJOURNAL
Comme un feuilleton d’été, vénéneux, généreux, subjecteux
Comme un feuilleton d’été, vénéneux, généreux, subjecteux

© Ph. g.ponthieu
Autant prévenir : je me suis laissé aller. Un vrai feuilleton. Ça m’a pris comme ça, de lâcher les freins. Je cause de ça : ce « monJOURNAL », du subjectif pur jus. Je cause aussi d’Avignon et de la crise de foi(e) que ça m’a donné – une sorte d’hépatite K comme Kulture : la greffe bizness provoque un rejet violent chez moi. Mes anticorps, j’en parle aussi à propos des grands-messes de musique classique. Brahms en quatuor de chambre pour un amphi de 2.000 places, ça m’assomme. Mais il s’en passe de belles à La Roque-d’Anthéron… où j’attrappe aussi des crampes d’estomac, pour cause d’une certaine littérature. Lit & rature, j’en étais là à donf’, heureusement sauvé par Napoléon, très fort en jazz, le guss. Si. A la Seyne-sur-Mer où je vous emmène, allez !
→
Fatiguant tout de même d’écrire, d’écrire tous les jours, de pas dire trop de conneries, autant que possible, de pas faire que ça non plus, merde. Y a le glandage, cet art d’ordonner le rien autour de pas grand chose, si ce n’est, tout de même, le temps qui passe – et ne revient jamais. Cette vacherie à ne jamais manquer, ce robinet qui fuit sans cesse, avec ses problèmes à la con qui empêchent de savourer chaque goutte comme une éternité plus qu’éphémère.
Fatiguant, eh oh !, t’es pas obligé hein ! T’es pas à la tâche, à la pige, au turbin forcé. C’est vrai. Fatiguant mais stimulant. Au fond, pas si fatiguant que ça. Coquetterie d’intello acharné à se faire plaisir, à enfler son ego comme un jabot de ministre, suivez mon regard. Stimulant, alors de quoi tu te plains ? Me plains pas plus que Sisyphe poussant son rocher. Pas moins, surtout. Me rappelle mon camarade Langlois, dans un de ses bloc-notes de Politis, racontant ses affres hebdomadaires : être en alerte permanente, se gaver de tous les plats d’infos qui passent, canards, bouquins, émissions diverses, se prendre des gueules de bois avec des bitures de piquette. Et dégueuler tout ça, ouf, pour éviter l’indigestion, la surdose hépato-cérébrale (mortelle).
On a cette chance de journaleux, après tout, de pouvoir dé-gueuler, cette psychanalyse à la va-vite, la plume qui fait divan et nous autorise une névrose ordinaire de normalement névrosés : rouspéteurs patentés, dénonciateurs de travers, redresseurs de torts (de tords…). On en profite pour se planquer derrière tout ça. Vaudrait mieux pas soulever le masque… Sauf que nous, Langlois, moi… et les indispensables et modestes semblables (peu), on n’est pas les pires. Même qu’on sait en rigoler, et même se poiler carrément en nous voyant dans la glace avec cette image de sérieux-pas sérieux.
C’est « monJournal », hein, personne pour m’emmerder, à compter les signes, mater les fautes, la ramener ceci-cela. Je laboure où quand comme je veux. Zéro contrat. Tu prends tu laisses.
Je ne parlerai donc pas de gagner sa croûte, ça gâcherait tout. Profitons du vide vacancier. Et, dans le genre de vide, y a pire : ma pointe de compas, je la plante là où je me suis planté, j’écarte pour faire 100 km, à peu près. Et ce cercle-là enserre, à se demander pourquoi, toute la culture marchande. Allez, j’élargis à 200 et comme ça je vais de Montpellier à Juan-les-Pins. Ça englobe, ou presque et du moins par échantillons, le tout-culturel européen, un concentré de l’offre culturo-biznessoïde.
Et cette année tout spécialement, je ne sais trop pourquoi, l’âge, la chaleur, l’Europe mondialisante…, l’exhibition m’a paru plus gerbante que jamais.
 Avignon, pour commencer. Un temple de marchands déguisés en artistes. Ce n’est certes pas nouveau mais je l’ai plus mal pris que dab. Justement, est-ce aussi l’habitude, les ornières de la chose ? Ou tournerai-je vin-aigre et vieux con ? Le mieux, ça reste le théâtre « live » avec les copains, autour d’un plat et d’une boutanche, ou deux. Largement le mieux. Mille fois plus mieux que les deux spectacles vus, même le mieux, l’autre, tellement tarte. Autant dire que j’ai rien-vu, ce qui m’a toutefois suffi pour cette année, tandis que les médias, ah-ah !, occupaient la cour des bonni-menteurs avec, enfin, une petite odeur de poudre, un filet de scandale autour du « in » soudain investi par des grincheux un peu gueulards, soudain et enfin porteurs d’une rébellion d’opérette, non mais, de qui s’moque-t-on ?
Avignon, pour commencer. Un temple de marchands déguisés en artistes. Ce n’est certes pas nouveau mais je l’ai plus mal pris que dab. Justement, est-ce aussi l’habitude, les ornières de la chose ? Ou tournerai-je vin-aigre et vieux con ? Le mieux, ça reste le théâtre « live » avec les copains, autour d’un plat et d’une boutanche, ou deux. Largement le mieux. Mille fois plus mieux que les deux spectacles vus, même le mieux, l’autre, tellement tarte. Autant dire que j’ai rien-vu, ce qui m’a toutefois suffi pour cette année, tandis que les médias, ah-ah !, occupaient la cour des bonni-menteurs avec, enfin, une petite odeur de poudre, un filet de scandale autour du « in » soudain investi par des grincheux un peu gueulards, soudain et enfin porteurs d’une rébellion d’opérette, non mais, de qui s’moque-t-on ? Joie simple de nos amis les journalistes s’accaparant la mini-jacquerie qui ravivait quelques parfums de scandales d’antan. Mais diantre que ce fut laborieux à
faire prendre, cette mayonnaise, cette avignonnaise ! Laborieux et vain. N’est pas Julian Beck-Judith Malina qui veut. Excusez, les plus jeunes, je cause du Living, cette bande d’anars venus dynamiter « le théâtre bourgeois » – ce qui avait un certain sens, au sortir de 68 et des sens interdits. Une révolte, sire, pas « la » Révolution – ça se serait su.
Donc, en 2005, ils en sont encore à se faire de gentilles frayeurs sur fond de nostalgie 68-tarde… Est-ce bien cela qui peut se lire sous les provocs ordinaires, so-phis-ti-quées de mises en scène à base d’installations, de performances, de rendement. Un goût édulcoré – le sucre sans sucre – du Paradise now et du Living theater : au pied de la lettre, théâtre vivant, oui!
L’art contemporain, à l’image du contemporain que nous vivons. Aujourd’hui, en modernité spectaculaire, la moindre des audaces est de foutre les comédiens à poil. C’est d’un banal. Ah ? Bien. Alors qu’ils se pissent et se conchient dessus, et se branlent, mais artistement, hein ! Artiste-ment. Misère, épouvante. Même pas drôle. Pas de quoi emballer la machine à polémique, fatiguée, saturée, au bout du rouleau. Un autre défi revient à jouer la montre, tel cet horloger déréglé d’Olivier Py. Dix heures de spectacle. M’y suis refusé, par principe. Non mais, pour qui il se/me prend ?
Avignon, je le vois ainsi : après les fastes affairistes, les crises sociales des dernières années, le vide de sens – qu’est-ce donc, enfin, que le théâtre sinon, toujours, une quête du sens à vivre ? –, après… A l’image de notre société bien plus déglinguée encore qu’en avril 68, je trouve, et ici, et dans le monde surtout.
Soixante ans après. Hiroshima comme autre holocauste. J’entends des horreurs horribles, notamment à la radio (France Culture). Tandis que le « nouvel » Iran bande son arc atomique, l’Europe ses muscles rachos, Bush sa bite, encore. Tout ce qui peut arriver arrivera. Postulat, horrible. Sauvons-nous vite !
 Aimé-je Brahms ? Vérification faite, pas trop. Ce n’est pas, remarquez, que la question m’ait spécialement tarabusté. Ni même que j’aurais pu avoir une remontée de Sagan, un acné juvénile autant que tardif, ou je ne sais quoi. Un concert me tendait les esgourdes à la Roque - d’Anthéron, cette Mecque estivale du piano mondialisé, à une portée de tong de ma case. L’endroit est sublime, je l’ai déjà écrit ici à propos du contrebassiste Charlie Haden qui a pu entrer dans l’endroit consacré par l’entremise de Gonzalo Rubalcaba, pianiste lui. Et cætera, je ne vais pas vous refaire l’article, suffit de cliquer ici, pas là.
Aimé-je Brahms ? Vérification faite, pas trop. Ce n’est pas, remarquez, que la question m’ait spécialement tarabusté. Ni même que j’aurais pu avoir une remontée de Sagan, un acné juvénile autant que tardif, ou je ne sais quoi. Un concert me tendait les esgourdes à la Roque - d’Anthéron, cette Mecque estivale du piano mondialisé, à une portée de tong de ma case. L’endroit est sublime, je l’ai déjà écrit ici à propos du contrebassiste Charlie Haden qui a pu entrer dans l’endroit consacré par l’entremise de Gonzalo Rubalcaba, pianiste lui. Et cætera, je ne vais pas vous refaire l’article, suffit de cliquer ici, pas là. Ce soir-là (31/07), Brahms venait après l’entracte. Bien après Schumann, et Bartok, et un certain Cerha, Friedrich, compositeur autrichien contemporain, et même vivant. Je raconte ça, qui n’aurait ici aucun intérêt. Sauf que.
Sauf que ce concert me barbe. Bien sûr, c’est toujours de la musique, ô combien. La question est autre, et même double ou plus : celle de sa représentation sociale et celle de ma perception. En fait les deux s’imbriquent. J’ai trop vécu, connu, aimé la révolution du jazz pour éprouver quelque nostalgie de l’Ancien régime. Lequel a aussi connu ses révolutionnaires, et comment ! Je ne rejette rien, rien de rien de toute musique – je dis bien toute, depuis les origines perdues. Et pour s'en tenir aux vieilles stars, depuis Jean-Sébastien, Amadeus, Ludwig, Johannes, Robert, Gustav, Béla, Alban, Olivier, Karl, Pierre, Pierre encore, Michel, Yannis aussi. Je m’épuiserais, ayant franchi les frontières des genres.
Ce concert m’emmerde même, sans plus. Il me donne à observer, à penser. Toujours ça. Le public, si conventionnel, l’écoute coincée comme des culs. Pourquoi donc tant de culs coincés, me dis-je ? Ben oui, en acoustique, les musiciens si loin, le moindre froissement de soie résonne comme un coup de tonnerre. Alors, pas question de risquer le moindre pet ! D’où les fesses serrées à bloc. Pas question de se lâcher. Encore moins de se relâcher et de souffler un coup, comme lors d’un orage à la Jo Jones. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je laisse mon observation aux musicologues, j’aide la science.
Ce concert est aussi retransmis par France Musiques. On entend, et on voit, le jeune et blondinet spiqueur sous sa tente-studio, distiller son savoir précieux sur le ton compassé dûment éprouvé par une lignée de prédécesseurs. Il fait comme on lui a dit de faire. Sans bruit, sans pet incongru, tiens. Manquerait plus que ça, une révolution en direct. Viva Zapata en plein Bartok et ses « Contrastes pour clarinette, violon et piano ». La musique de chambre, c’est fait pour s’endormir, non ?
J’aime assez la vision d’un sacrilège. Et puisque je m’emmmerde plus encore, je me fais du ciné, de la BD… Je vois cette jolie dame, robe blanche, s’éclipser en loucedé, dans l’accalmie espérée d’un entre-deux mouvements. Elle fait des pointes sur le gravier blanc qui n’en crisse pas moins. Elle s’applique pourtant, à pas de loup, avec une discrétion désespérée sur laquelle mille paires d’yeux sont braqués. Les distractions sont si rares. De plus, ça se passe tout près de la scène, à la barbe des musiciens risquant la déconcentration.
La voilà donc qui lève la jambe droite pour franchir le lourd cordon de velours rouge à l’ancienne censé interdire l’accès aux retardataires. Mais pas prévu pour les refuzniks. Et, sans doute entravée par l’étroitesse de la robe, voilà la jambe comme gênée aux entournures. Et le talon de l’élégant escarpin doré se prend dans le cordon rouge. Allegro vivace, les musiciens attaquent leur dernier mouvement. A l’instant précis où la fuyarde part en vol plané. Dans sa courte trajectoire, elle entraîne en cascade les porte-cordons en métal chromé dont le troisième, rattaché à une palissade en bois, provoque le renversement de celle-ci sur un boîtier électrique qui crache une gerbe de 14-juillet. Obscurité complète. Ooooh ! s’exclame le public soudain décoincé.
Tandis que le quatuor, très pro, continue de jouer à l’aveugle – ce qui ne change rien –, Monsieur France Musique se permet une intervention (« nous sommes retransmis en direct ») à l’intention des chers auditeurs, que des haut-parleurs répercutent pour l’assistance. Inébranlable, il explique qu’un incident technique a perturbé le concert interprété par (il redonne les noms des musiciens), qui va cependant se poursuivre. Allo Paris ? Vous m’entendez ? La liaison a été coupée, de même que toute l’électricité des parages. On s’en fout. Et ça continue à jouer de plus belle. De plus en plus belle.
 Libérés des contraintes écrites, les musicos se lèvent et se lancent dans l’impro. Des airs remontent à la surface, tandis que le pianiste se met à swinguer. Si ! Alors, je l’accompagne en frappant dans les mains. Et mille paires de mains se mettent à battre ! L’alto, on dirait qu’il s’est mis au sax, le violon au soprano et le violoncelle à la contrebasse. Oh when the saints ! Faut bien un début. Tout le monde connaît. Coltrane, on verra. Ça chauffe un max, ça tape du pied sur les gradins en tôle galvanisée qui vibrent comme à Furiani. Et s’effondrent pareil, mais mollement, gentils les échafaudages de la Roque-d’Anthéron, pas méchants, déposant tout le monde en douceur sur la pelouse du château de Florans, au pied des séquoias géants.
Libérés des contraintes écrites, les musicos se lèvent et se lancent dans l’impro. Des airs remontent à la surface, tandis que le pianiste se met à swinguer. Si ! Alors, je l’accompagne en frappant dans les mains. Et mille paires de mains se mettent à battre ! L’alto, on dirait qu’il s’est mis au sax, le violon au soprano et le violoncelle à la contrebasse. Oh when the saints ! Faut bien un début. Tout le monde connaît. Coltrane, on verra. Ça chauffe un max, ça tape du pied sur les gradins en tôle galvanisée qui vibrent comme à Furiani. Et s’effondrent pareil, mais mollement, gentils les échafaudages de la Roque-d’Anthéron, pas méchants, déposant tout le monde en douceur sur la pelouse du château de Florans, au pied des séquoias géants. Par la sauvagerie musicale alléchés, les loulous de la zone (il les fallait pour la suite) rappliquent bientôt, lèvent les plus aptes des bourgeoises pour les encanailler dans des rocks d’enfer (« Le jazz, c’est du rock » comme disait Eddy Mitchell dans son temps de jeune con). Là, on est dans du Fellini plein pot. C’est Prova d’orchestra à la sauce au pistou et on n’est pas loin d’un 1789, d’une prise de la bastille de la Roque, son seigneur décapité – non, on va pas recommencer ces conneries ! Le châtelain, gentil, social, aura pris le vent de l’Histoire, ouvert coffres-forts et comptes en banque, convoqué tout de go les états-généraux de l’économie distributive. Sacré Paul Onoratini ! (président-fondateur du festival).
 Bon, je vous emmmmerde ou quoi ? Car ce n’est pas tout. Je les abandonne à leur délire, tandis que je retrouve la dame à la robe blanche à l’origine de Tout. Madame Effet-Papillon, auteure de la théorie du Chaos, vous savez… Elle s’était réfugiée dans l’allée des séquoias séculaires, là où les marchands du temple culturel font commerce de disques et de livres. Détachée, apparemment, des conséquences créatrices de sa gestuelle, elle feuillette un bouquin. Je l’interviewe (prétexte pro, on ne se refait pas) sur le thème de l’ennui musical. Elle croit que je la drague (soit !) et me rembarre en reposant sur l’étal le récent Christian Gailly, Dernier amour – que j’achète avant de quitter les lieux.
Bon, je vous emmmmerde ou quoi ? Car ce n’est pas tout. Je les abandonne à leur délire, tandis que je retrouve la dame à la robe blanche à l’origine de Tout. Madame Effet-Papillon, auteure de la théorie du Chaos, vous savez… Elle s’était réfugiée dans l’allée des séquoias séculaires, là où les marchands du temple culturel font commerce de disques et de livres. Détachée, apparemment, des conséquences créatrices de sa gestuelle, elle feuillette un bouquin. Je l’interviewe (prétexte pro, on ne se refait pas) sur le thème de l’ennui musical. Elle croit que je la drague (soit !) et me rembarre en reposant sur l’étal le récent Christian Gailly, Dernier amour – que j’achète avant de quitter les lieux.J’avais bien aimé Un Soir au club, touchante histoire d’amour en milieu jazzeux. Là, ça part de Haydn, un quatuor aussi… La coïncidence m’envoie un clin d’œil. Donc, Paul est compositeur. Assiste à son dernier concert. Son œuvre est sifflée. S’en fout car il va crever dans un ou deux jours. Ainsi en phase finale, cet homme à femmes en rencontre une aux yeux injectés de sang, bon, puis une autre, bellissime of course, qui viendra le border dans son lit de mort après lui avoir offert un dernier tour dans sa Morgan (une décapotable, idéal pour frimer en littoral touristique). De plus, si si !, elle est aussi musicienne, pianiste… Et caetera. La meilleure idée de Gailly, c’est d’avoir torché sa bluette en 120 pages. A un euro la dizaine, c’est tout de même cher payé.

La Seyne-sur-Mer, Fort Napoléon. Ce cher Watson et son impérial quartet. © Ph. gp
Julien Gracq nous avait avertis, à propos de « littérature à l’estomac ». Pierre Jourde a radicalisé la formule avec sa Littérature sans estomac, salutaire pamphlet où il se fait ces écrivailleurs qui veulent se payer notre tronche. Je l’ai repris en main pour me remettre du dernier Gailly – qui ne pouvait y figurer puisque ficelé après le Jourde (2003). Sans doute l’eut-il enfilé sur sa brochette aux côtés des Sollers, Angot, Beigbeder, Darrieusecq, Rollin, Laurens et autres sous-produits germanopratins. Quand je palpe ça sur les gondoles du supermarché livresque, j’ai le gerbi. J’entends encore ces mêmes éditeurs me renvoyer dans les cordes avec mon roman – inédit, forcément inédit* –, au prétexte qu’« on n’écrit plus comme ça de nos jours ». Ah bon. Non, ce qui se fait aujourd’hui, c’est dans cette matière-là, oui, qui plaît bien à la clientèle, voyez-vous.
Cette époque en particulier, la nôtre, baigne dans la mode jusqu’à en crever. Robert, le Petit, est tellement juste sur le mot : « Goûts collectifs, manières de vivre, de sentir qui paraissent de bon ton à un moment donné dans une société déterminée. Les engouements de la mode. → vogue. Lancer une mode. Une mode éphémère. « Il est des modes jusque dans la façon de souffrir ou d'aimer » (André Gide). – Loc. À LA MODE : conforme au goût du jour, en vogue. Être, revenir à la mode. Restaurants, plages à la mode. C'est à la mode (cf. C'est à la page*, le dernier cri*, dans le vent*). Ce n'est plus à la mode, c'est passé de mode. → démodé. Personne, chanteur à la mode. → fam. branché, câblé. »
J’ajoute que la mode, pour moi hein, c’est aussi le monde du cliché. Fatalement, s’agissant de la reproduction de choses, « idées », comportements, apparences et gens ; et de reproduction à échelle de masse, par obligation de rentabilité. On singe l’originalité – fausse – qui permet la duplication en grandes séries semblables. Gailly, c’est bourré de clichetons, parfois clinquants, ce qui créé l’illusion. Je cherche un prélèvement. Ça foisonne. Tiens, p. 21 : « Personne avec Paul ne regardait les camaïeux bleu sombre, les échelles turquoises d’un soleil qui chaque soir ici prenait son bain dans les eaux noires du lac. » Car on n’est pas encore arrivé à la mer. Nous y voilà : « Là où commence la côte sauvage. Ses yeux se posèrent sur une tâche gris clair. Bien visible sur le sable humide jaune foncé. Près d’un rocher noir. Magnifique rapport de couleurs. Hasard ou simple désir de faire beau. » (p. 61).
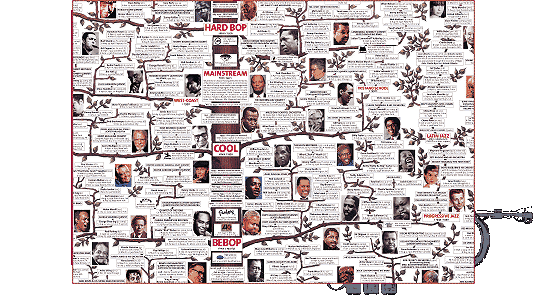
J’arrête. Plutôt parler de ce que j’aime. J’en reviens donc au jazz. Je dirais bien que cette musique, c’est de la chasse au cliché. Elle en comporte, bien sûr, mais ses re-créateurs, insatiables, n’ont de cesse de les remiser aussitôt repérés. Voilà pourquoi on devrait dire « les » jazz, à l’image de son histoire, sa généalogie – voyez un aperçu de son arbre [ci-dessus], il trône sur un mur d’escalier à la maison, la Jazzine. Pourquoi un tel foisonnement, à la différence du classique, si linéaire en général ? Vaste sujet. (Je l’aborde dans un autre papier en cours sur Keith Jarrett et l’improvisation. Vous serez avertis.) L’impro, c’est un peu comme l’irruption de Dada et du surréalisme dans l’art et la littérature ; c’est l’écriture qui se dynamite pour se recréer et poursuivre le mouvement de l’art. Le mouvement, pas la bougeotte, celle du slogan imbécile « parce que le monde bouge ». Ah vraiment ? La pub, comme agent contaminateur de cette grave épidémie de « bougeure » généralisée, au nom de l’obsolescence triomphante du Tout-marchandifié. Faut que ça roule, que ça transporte, que ça touristifie, que ça culturise. Et que ça y aille des flux tendus, des stocks rotatifs, du développement durable et autres enculades à croissance forte, à rendement optimisé, pour une sécurité accrue. Clichetons encore que cette salade « globalisée ». Car les clichés, on l’a dit, ayant contaminé le langage, gagnent choses et gens jusqu’à les rendre malades à mourir. Et vice versa.
 Oh mais je m’énerve, là, dis. Je voulais juste en revenir au jazz. Parce que l’autre soir, à La Seyne-sur-Mer, j’ai connu de belles heures au Festival dit du Fort-Napoléon. Beau détournement d’un lieu militaire rendu aux civilités azuréennes. C’était la vingtième édition de ce qui me semble, à moi hein, « ze » festival par excellence. C’est l’anti-frime, donc l’anti-clichetons et aussi l’anti-arnaque. Deux concerts pour 15 euros la soirée (ça a tout de même bien augmenté cette année…), un coin restauration-sympa à 10. Et des expos aux trois des quatre coins de la forteresse – le quatrième servant de coulisse aux musiciens. Et pas n’importe quoi comme expo – peintures de Fromanger [son affiche, ci-contre] et Giacobazzi [voir le site du festival]. Je n’évoquerai ici que les photos de Marcel Fleiss qui, de plus, font l’objet d’un livre marquant le XXe anniversaire du festival. Intitulé « Now’s the time » [C’est bien l’heure]. Je parlerai du « Flash-back sur une passion », texte fort de Jean-Jacques Lebel qui plante puissamment le jazz dans l’histoire sociale et artistique, picturale, littéraire, surréaliste. (Édition Bleu Outre-Mers].
Oh mais je m’énerve, là, dis. Je voulais juste en revenir au jazz. Parce que l’autre soir, à La Seyne-sur-Mer, j’ai connu de belles heures au Festival dit du Fort-Napoléon. Beau détournement d’un lieu militaire rendu aux civilités azuréennes. C’était la vingtième édition de ce qui me semble, à moi hein, « ze » festival par excellence. C’est l’anti-frime, donc l’anti-clichetons et aussi l’anti-arnaque. Deux concerts pour 15 euros la soirée (ça a tout de même bien augmenté cette année…), un coin restauration-sympa à 10. Et des expos aux trois des quatre coins de la forteresse – le quatrième servant de coulisse aux musiciens. Et pas n’importe quoi comme expo – peintures de Fromanger [son affiche, ci-contre] et Giacobazzi [voir le site du festival]. Je n’évoquerai ici que les photos de Marcel Fleiss qui, de plus, font l’objet d’un livre marquant le XXe anniversaire du festival. Intitulé « Now’s the time » [C’est bien l’heure]. Je parlerai du « Flash-back sur une passion », texte fort de Jean-Jacques Lebel qui plante puissamment le jazz dans l’histoire sociale et artistique, picturale, littéraire, surréaliste. (Édition Bleu Outre-Mers].Et question musique, gâtés les tympans ! L’an dernier, souvenir fort d’Henry Grimes, comme sorti des limbes, lui l’ancien bassiste d’Albert Ayler, entre autres. Cette année, Eric Watson, un de mes chouchous. J’en ferais un plat de son quartet avec Christof Lauer, sax, Sébastien Boisseau, cb, Christophe Marguet, batt. De même de François Couturier qui invente, rien de moins, un nouvel art du trio à partir de compos d’un auteur catalan dont j’ai oublié le nom.
Bref, sortez aussi des clichetons festivaliers, les grosses cavaleries, les grands-messes à tiroirs-caisse genre Juan-les-Pins avec un Keith Jarrett qui, en plus, a fait la gueule (à ce qu’ont dit les gazettiers).
M’enfin, les rois du clichetons, ça reste bien « mes chers confrères ». Là, ça dépasse les exploits du Guiness’. Sur mon blog « c’est pour dire », j’avais prévu une rubrique « Mort aux clichetons ! ». J’y ai renoncé pour cause d’excès répétitifs, surtout chez les journalistes sportifs, les rois des rois avec leurs « résultats logiques », leurs « qui caracole en tête » sur « la plus belle avenue du monde ». De celle-là, ils ne sauraient détenir le monopole… Sans parler des approximations, des dérapages non contrôlés de la gent audiovisuelle : un tel mort d’une « embellie cérébrale » – ce qui lui a manqué au Mathieu P. sur France Inter, pour se reprendre. Ou encore, entendu ce midi [04/08/05], même station, par Clotilde D. annonçant que les rues étaient calmes à Nouache-coque. Bah, c’est si loin tout ça.
→ Les images, de haut en bas, quand il n'y a pas de légende :
– Concert à Charlie-Free (Vitroles)
– Julian Beck au faîte de la gloire du Living (et bien dominateur pour un libertaire…)
– Brahms, le quatuor, une certaine froideur
– L'orchestre comme forme sociale et lieu de révolte, selon Fellini
– Château de Florans, La Roque-d'Anthéron.
* Télécharger Histoire d'un homme dispersé, "roman documentaire" de Gérard Ponthieu (en pdf, 546 Ko).




